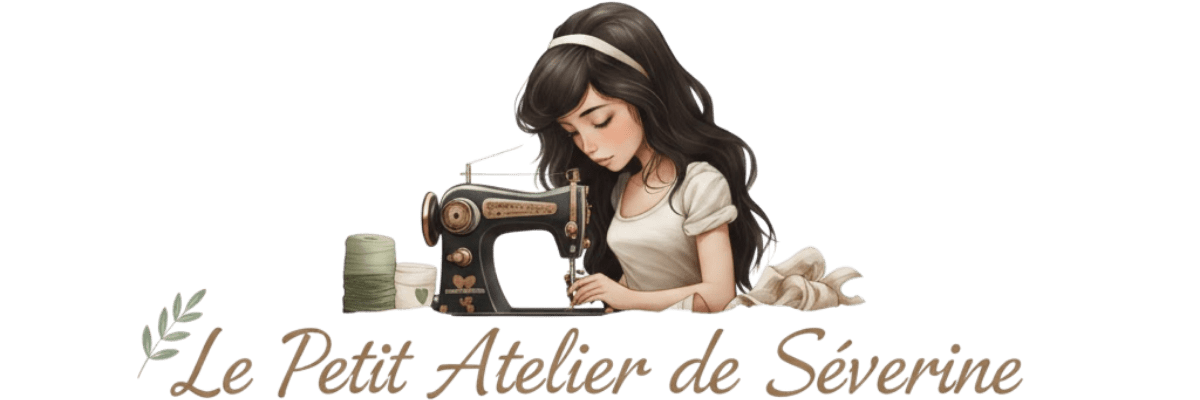Ce que mon histoire m’a appris : 6 leçons sur le traumatisme et la survie
Introduction : Au-delà de la résilience
On imagine souvent la survie après un traumatisme comme une ligne droite vers la guérison. Mon histoire m’a appris que c’est un chemin bien plus sombre, où la résilience n’est pas une armure brillante, mais une force brute qui s’accroche à la vie dans le silence et l’obscurité. En écrivant « Ce qu’ils ont laissé de moi », j’ai voulu témoigner avec une honnêteté brutale pour déconstruire les idées reçues sur la souffrance. Raconter mon histoire m’a permis de mettre des mots sur des leçons profondes, souvent douloureuses, sur la nature du traumatisme et la force insoupçonnée qu’il faut pour simplement tenir bon. Voici six prises de conscience qui ont marqué mon parcours.
1. Le don qui devient une malédiction : Quand l’intelligence isole
Quand j’avais quatre ans, savoir lire était une source de joie immense, une fierté secrète qui bouillonnait en moi . Mais dans le monde des adultes, ce don n’a suscité ni admiration ni encouragement. Au contraire, il est devenu la cause de mon isolement et de punitions d’une cruauté insensée. Le jour où j’ai partagé mon talent avec mon institutrice, elle a répondu par une indifférence glaciale avant de me transférer brutalement dans la classe des grands, un environnement où je me suis immédiatement sentie étrangère .
Ce n’était que le début du calvaire. Pour une simple agitation, cette enseignante m’a enfermée dans les toilettes sombres des adultes. Prisonnière du noir total, ma panique a été accueillie par une menace terrible : « Si tu ne te tais pas, je te mettrai la tête dans les toilettes. ». Cette expérience a engendré mes terreurs nocturnes, les « loups rouges ». Mais le refuge de la maison n’existait pas. Fatigué de mes cris, mon père a perdu patience et une fessée est venue punir mes pleurs . J’ai compris alors que je devais affronter mes démons seule et en silence. Cette transformation d’un don en fardeau a culminé le dernier jour d’école, où la cruauté de l’enseignante s’est cristallisée en une phrase d’une violence inouïe.
Moi aussi, je me réjouis de ne plus jamais voir ta figure horrible.
2. La maladie comme arme : Le chantage affectif qui paralyse
La schizophrénie de ma mère était une tragédie. Mais dans notre huis clos familial, cette maladie est devenue une arme de contrôle et de culpabilisation. Le soir de mes six ans, alors que ma mère était emportée en ambulance, mon père m’a rendue responsable . Il ne s’est pas contenté de hurler son accusation ; il s’est jeté sur moi, ses doigts se refermant sur mes cheveux, tirant si fort que mon cuir chevelu semblait se déchirer. Il m’a traînée jusqu’à ma chambre et m’a projetée violemment contre l’armoire avant de me menacer : « Si tu continues à pleurer, je vais te tuer, tu m’entends ? Je vais te tuer ! » .
Cette accusation initiale m’a marquée au fer rouge, créant une arme psychologique que mon frère maniera des années plus tard avec une précision cruelle pour me contraindre au silence face à ses propres abus : « Si tu dis quoi que ce soit, elle retombera malade. Ce sera ta faute. ». Ce chantage m’a piégée dans une solitude totale, me rendant gardienne de la santé mentale de ma mère et m’empêchant de chercher de l’aide. Mon silence est devenu le prix à payer pour la fragile stabilité familiale.
Tout est de ta faute ! Si tu n’étais pas née, rien de tout ça ne serait arrivé !
3. Le silence assourdissant des adultes : La solitude face au harcèlement
Mon histoire est hantée par l’échec des adultes qui m’entouraient. Le personnel scolaire, le chauffeur de bus, les surveillants… tous ont été témoins du harcèlement constant que je subissais, mais aucun n’est intervenu. Les autres enfants avaient la permission silencieuse de se moquer, d’insulter, de frapper. Pire, lorsque je cherchais de l’aide, leurs réponses me condamnaient : « C’est toi qui provoques ».
Cette absence de protection m’a poussée à un isolement total, comme lors de cet épisode terrible où des camarades m’ont jetée dans un buisson d’orties. Ne trouvant aucun refuge, j’ai fini par répondre à la violence par la violence. Un matin, après avoir été forcée par mon père à boire mon propre vomi, je suis montée dans le bus où les enfants me narguaient : « Hé, voilà la folle ! Sa mère est folle, elle aussi, forcement ! » . C’était la phrase de trop. Quelque chose a explosé en moi, et j’ai frappé, aveuglée par la rage. Ce faisant, je n’ai fait que renforcer mon étiquette de « mauvaise graine », m’enfermant un peu plus dans une solitude où même ma propre souffrance était retournée contre moi.
T’es vraiment une mauvaise graine, une petite peste ! On aurait mieux fait de ne jamais te laisser monter !
4. L’aide qui blesse : Quand le soin devient une forme d’abus
L’une des leçons les plus troublantes de mon parcours est la manière dont la notion de soin peut être pervertie pour devenir une forme d’abus. Des gestes censés apporter du réconfort se sont transformés en violations profondes de mon intégrité d’enfant.
Les massages de mon père : Sous prétexte de soulager mes douleurs au dos, mon père m’a imposé des massages qui sont rapidement devenus des attouchements. Ses mains s’attardaient, exploraient, violaient mon intimité sous le couvert d’un soin parental . La maison, qui aurait dû être un refuge, est devenue le théâtre d’un abus où le réconfort se mêlait au dégoût.
La « bénédiction » de la secte : Lorsque mes douleurs dorsales ont persisté, mon père m’a emmenée chercher une « bénédiction ». Placée au centre d’un cercle d’hommes, j’ai subi une nouvelle forme d’abus, psychologique cette fois. Le chef du groupe a lié ma souffrance physique à ma foi, me rendant responsable de ma propre douleur.
Dans ces deux cas, l’aide est devenue une arme. Le soin n’était plus un acte de bienveillance, mais un moyen de contrôle, de domination et de culpabilisation.
Si demain la douleur est encore là, c’est que tu manques de foi.
5. La lumière surgit là où on ne l’attend pas
Au milieu de cette obscurité presque totale, des éclats de lumière sont apparus, rares mais puissants. Ce sont des moments de bonté et de connexion humaine inattendus qui m’ont permis de continuer à survivre, même lorsque tout semblait perdu.
L’institutrice qui pleure : Après mon agression dans les orties, alors que j’étais murée dans le silence, mon institutrice m’a soignée avec une tendresse que je n’avais jamais connue . Et puis, elle a pleuré. Ses larmes ont été le premier signe d’empathie sincère que j’ai reçu d’un adulte, une reconnaissance silencieuse de ma souffrance qui a brisé, un instant, le mur de solitude.
Virgile, le sauveur : Alors que j’étais sur le point de sauter d’un pont, un inconnu m’a attrapée et serrée contre lui . Virgile ne m’a pas jugée, il n’a pas posé de questions. Il m’a offert une présence et les premiers mots de réconfort et d’espoir que je n’avais jamais entendus . Cette rencontre a été un tournant, la première lueur d’un amour qui peut sauver.
Ces instants, aussi fugaces soient-ils, ont été cruciaux. Ils ont été les points d’ancrage qui m’ont permis de ne pas sombrer complètement.
Rien ne vaut que tu mettes fin à ta vie. Un jour, tu trouveras le bonheur.
6. Survivre n’est pas guérir : Le combat intérieur permanent
Mon histoire rappelle une vérité fondamentale : échapper à un environnement abusif ne signifie pas être guéri. Le traumatisme continue de vivre en moi, comme une bête tapie dans l’ombre.
Mon corps, d’abord, a gardé la mémoire de la souffrance. Dès mes douze ans, j’ai enduré des douleurs dorsales chroniques que les adultes balayaient d’un revers de main : « à 12 ans, on n’a pas mal au dos ». Ces mots, lancés comme des sentences, m’ont condamnée au silence. Ce n’est que bien plus tard qu’un diagnostic a été posé : Spondylarthrite ankylosante, une maladie inflammatoire qui incarne physiquement un traumatisme longtemps nié.
Ensuite, la nourriture est devenue un champ de bataille. À l’internat, j’ai découvert une forme de maîtrise en me privant de manger. J’aimais cette sensation de ventre vide, j’étais enfin maîtresse de mon corps. Mais à la maison, le chaos reprenait le dessus, où j’étais forcée de manger puis je me faisais vomir en secret. Ce cycle illustre ma lutte incessante pour reprendre le pouvoir sur un corps et un esprit marqués au fer rouge. Survivre n’est pas une destination, mais un processus épuisant qui exige une force immense au quotidien.
Conclusion : La force de nommer les choses
Mon témoignage m’a enseigné que la résilience n’est pas un acte d’oubli, mais un acte de courage. Le courage de nommer l’innommable, de donner une voix à une souffrance trop longtemps niée et de faire exister une vérité que le monde préférerait ignorer. En partageant mon histoire, je ne tourne pas la page ; je la fais exister, pour moi et pour toutes celles et ceux que l’on n’a jamais écoutés. Mon récit vous laisse avec une question essentielle : et si la plus grande aide que nous pouvions apporter était simplement d’écouter, vraiment, celles et ceux que le silence a trop longtemps brisés ?
Pour découvrir mon histoire dans son intégralité, vous pouvez vous procurer « Ce qu’ils ont laissé de moi » via les liens ci-dessous. Merci pour votre lecture et votre soutien.
Rejoignez-nous : sur le groupe facebook Autour de « Ce qu’ils ont laissé de moi » : Parler, Lire, Reconstruire
Pour suivre mes autres projets d’écriture et d’art :
aller sur ma page auteur sur amazon
Merci de faire vivre ces mots au-delà du livre.
Séverine Mahieux